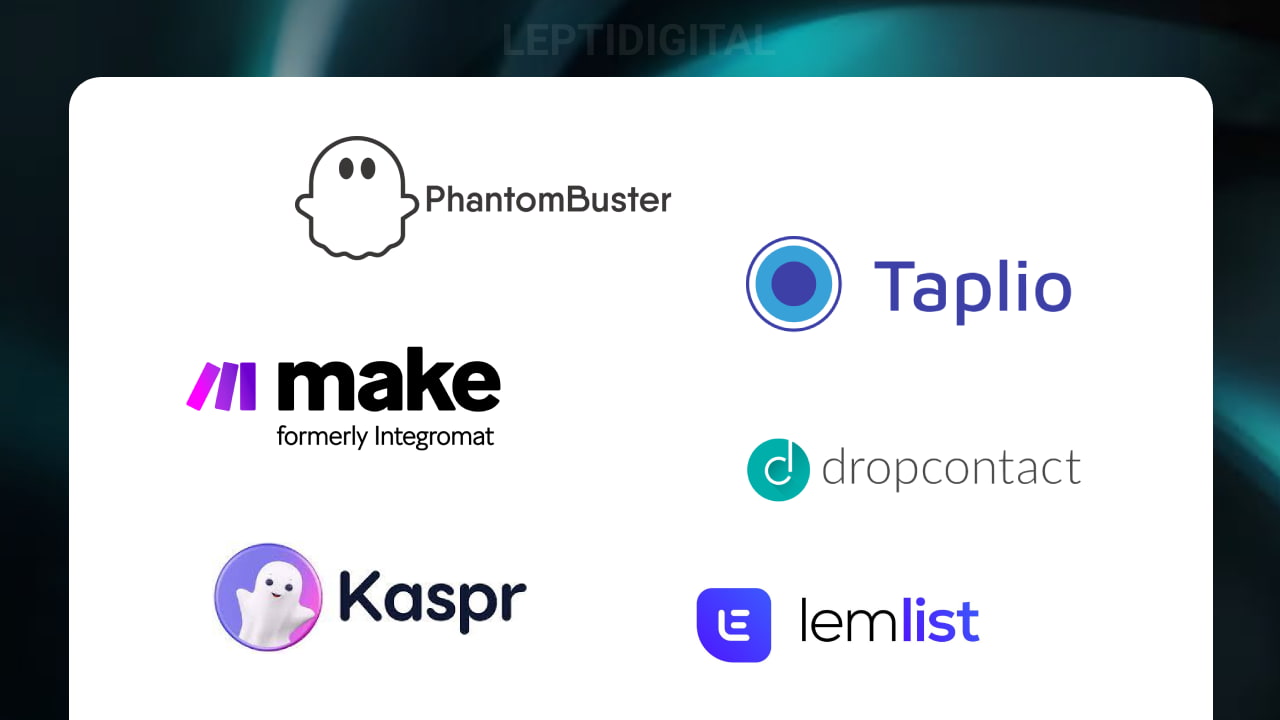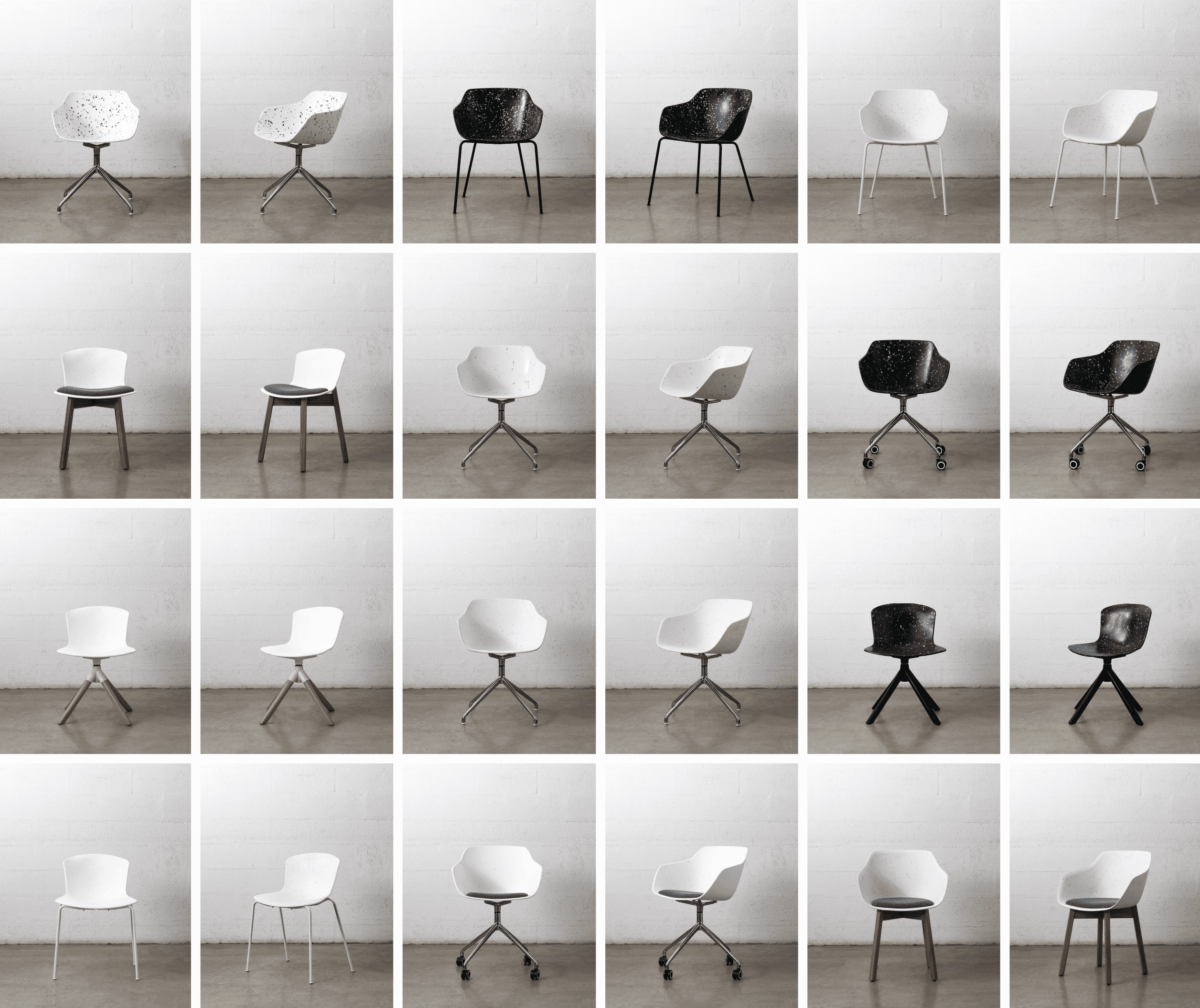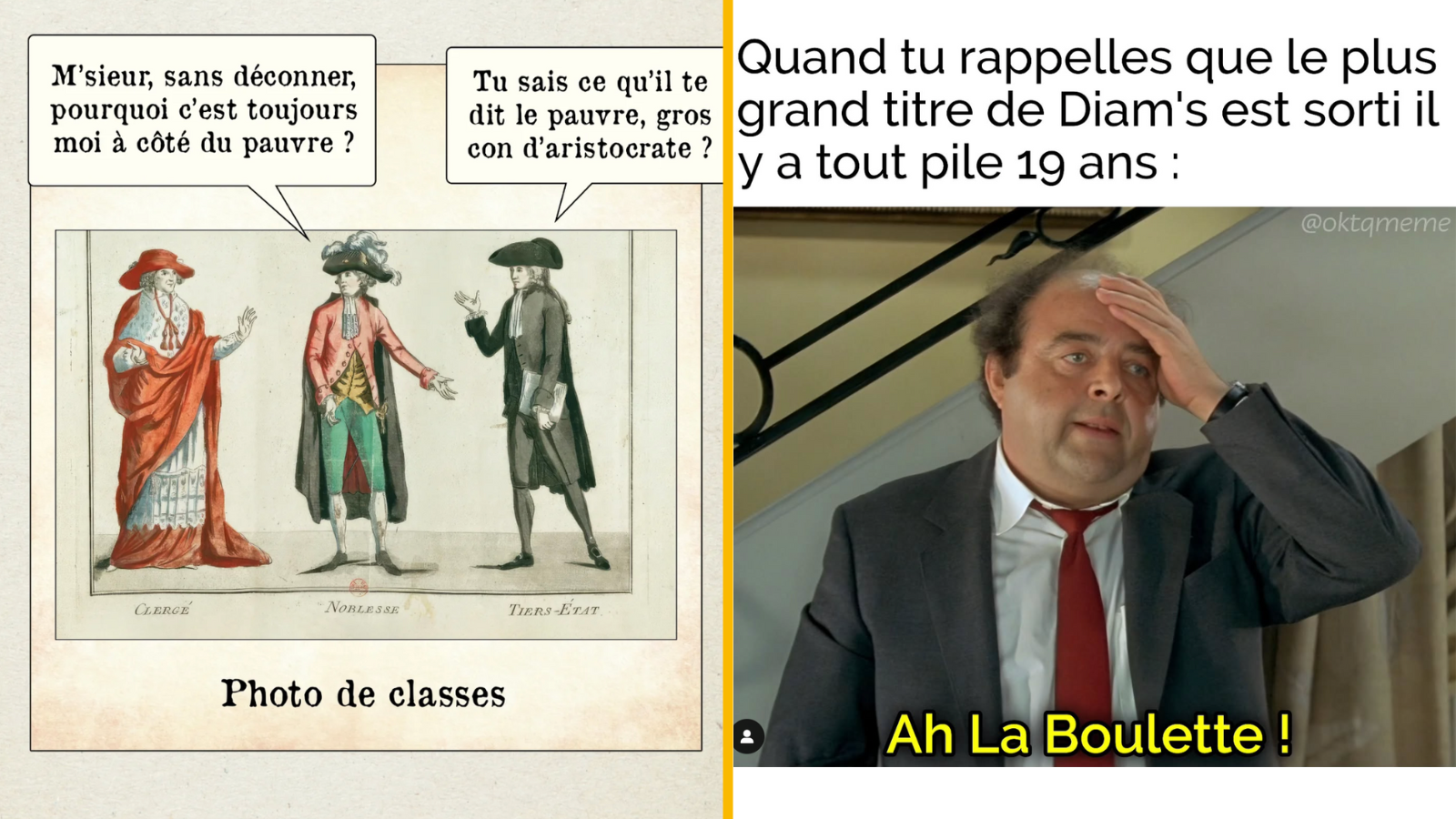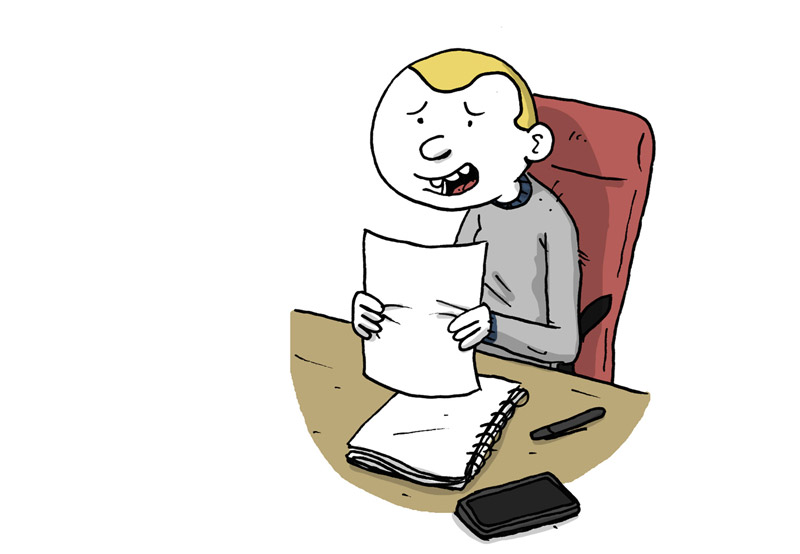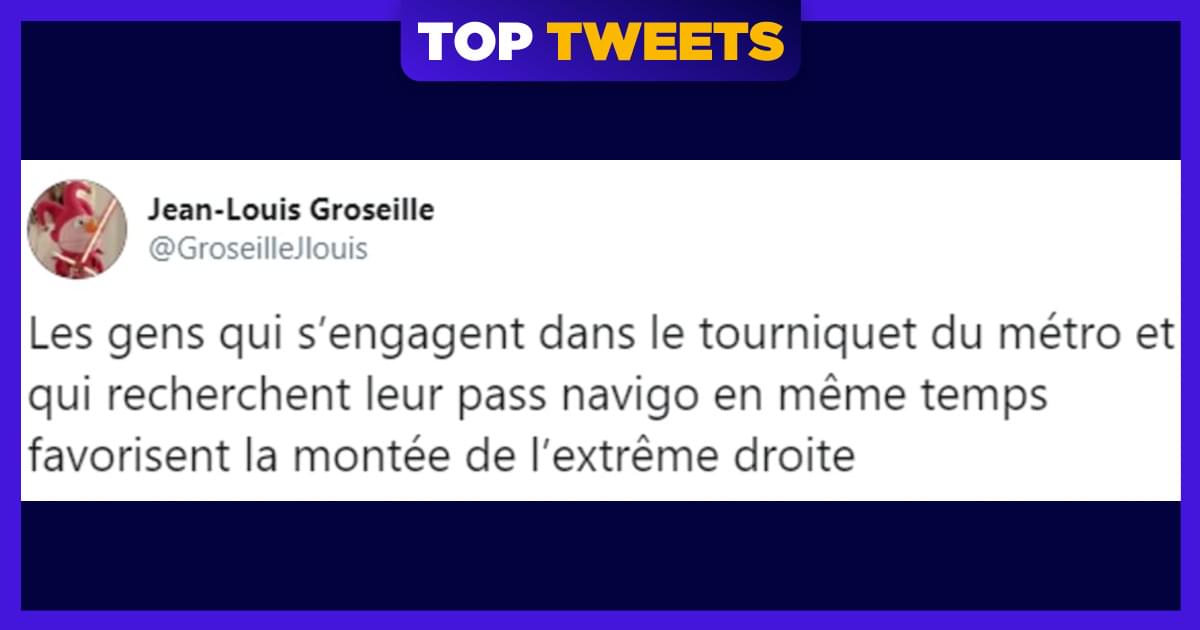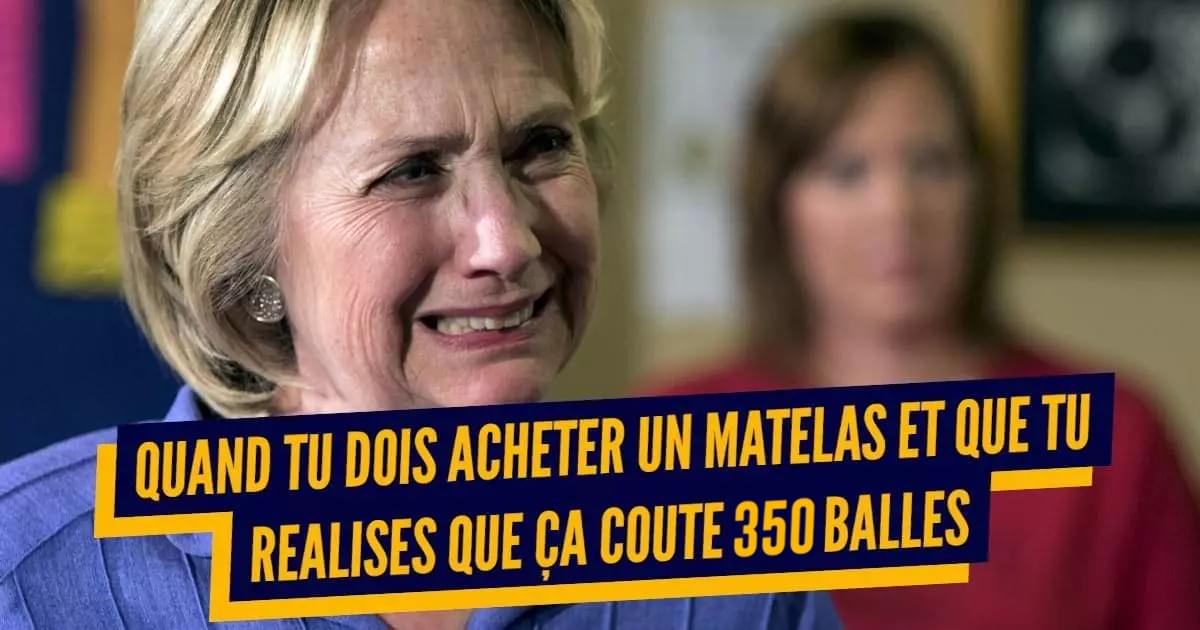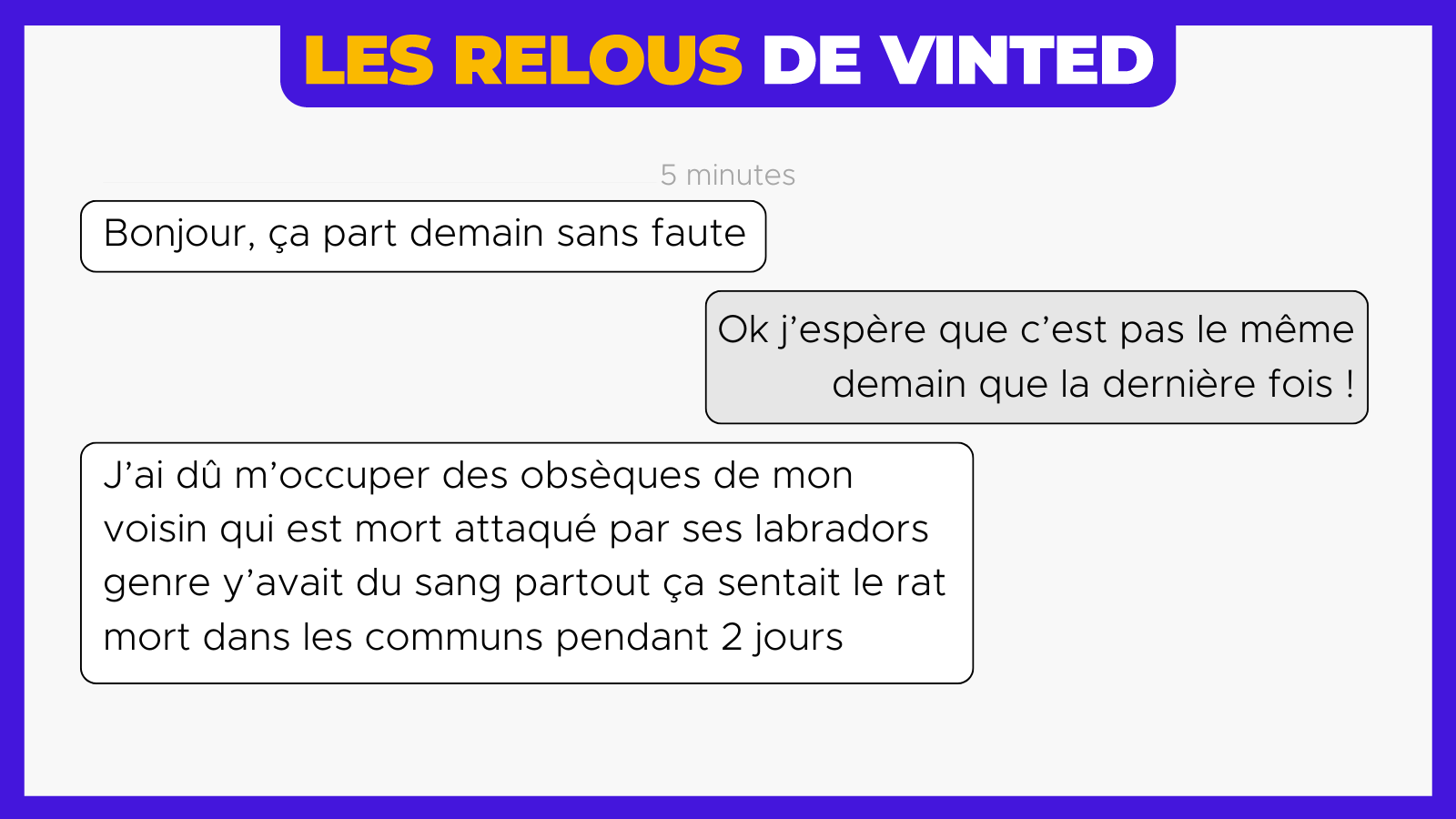Un aéroport sur la Seine, un éléphant à la Bastille… À quoi aurait pu ressembler Paris ?
Imaginez vous atterrir sur la Seine, grimper le long d’une tour de 700 mètres de haut en voiture, ou vous promener dans une immense serre végétale le long des Grands Boulevards… cela vous semble fou ? Pourtant, c’est le Paris qui aurait pu exister, si ces projets architecturaux ambitieux avaient vu le jour. On vous […]

Imaginez vous atterrir sur la Seine, grimper le long d’une tour de 700 mètres de haut en voiture, ou vous promener dans une immense serre végétale le long des Grands Boulevards… cela vous semble fou ? Pourtant, c’est le Paris qui aurait pu exister, si ces projets architecturaux ambitieux avaient vu le jour. On vous emmène dans un Paris alternatif, où l’on voit les choses en (très) grand !
Le “Phare du monde”, un phare accessible en voiture

Pour l’exposition universelle de 1937, Eugène Freyssinet imagine un projet complètement fou : une tour en béton armée de 700 mètres de haut et 130 mètres de diamètre, avec une route en colimaçon sur laquelle on pourrait monter… en voiture, jusqu’au sommet ! Ce “Phare du Monde” devait symboliser toutes les grandes avancées du XXe siècle : le béton armé, l’automobile et la radio diffusion. Elle aurait abrité un restaurant panoramique avec une vue spectaculaire (forcément, à 700 mètres !), mais aussi un solarium et un hôtel intégré à la structure. Les différents niveaux – tous accessibles en voiture – auraient été dédiés à plusieurs usages : une vaste coupole censée abriter des congrès et démonstrations scientifiques, une exposition permanente sur l’automobile, des services de communication à la base de la tour, et des centres sanitaires dans les niveaux supérieurs. Le projet ne verra jamais le jour, freiné par des problèmes techniques architecturaux et mécaniques.
La Colonne-Soleil, à la place de la Tour Eiffel ?

Cette tour aurait bien pu remplacer la Tour Eiffel ! Elle était sa grande rivale lors de l’exposition universelle de 1889. Imaginée par Jules Bourdais, elle consistait en un immense phare de 350 mètres de haut, capable d’éclairer toute la capitale et ses environs. Véritable ode aux avancées technologiques de l’époque, elle devait aussi abriter un musée de l’électricité. Cette compétition entre les deux tours pensées pour trôner sur les Champs de Mars incarne une lutte symbolique de la fin du XIXe : celle de l’académisme contre la modernité, de la pierre contre le fer. Spoiler alerte : c’est bien l’innovation qui l’a emporté, illustrée par Gustave Eiffel et ses créations modernes avec sa tour de métal et sa Statue de la Liberté.
Un éléphant géant place de la Bastille

Longtemps restée vide après la destruction de la prison pendant la Révolution, la place de la Bastille devient une grande place publique en 1792, et les projets se multiplient pour y ériger un monument commémoratif digne de son histoire. Au début du XIXe siècle, l’accès à l’eau n’est pas chose aisée à Paris : pour remédier à ce problème, Napoléon fait creuser le canal de l’Ourcq puis celui de Saint-Denis et de Saint-Martin afin d’alimenter la ville en eau potable. En 1806, il ordonne la construction de 15 nouvelles fontaines, et en 1809, l’idée prend forme : il veut ériger une gigantesque fontaine en forme d’éléphant sur la place de la Bastille -une manière de célébrer l’arrivée de l’eau. Le projet est colossal : un éléphant de 15m de haut et de 16 m de long, en bronze, trônant au centre d’un grand bassin circulaire. L’eau, acheminée via le canal Saint-Martin jaillirait de sa trompe. Pendant quelques années, les parisiens ont pu admirer une maquette en plâtre grandeur nature, stockée dans un hangar sur un côté de la place. Mais le projet s’effondre en même temps que l’Empire, et il n’en reste aujourd’hui que le socle, sur lequel repose désormais la colonne de Juillet. La Fontaine de l’Éléphant, imaginée par Alavoine, est pourtant immortalisée par Victor Hugo dans Les Misérables : Gavroche y trouve refuge.
«Il y a vingt ans, on voyait encore dans l’angle sud-ouest de la place de la Bastille, près de la gare, un monument bizarre qui s’est effacé déjà de la mémoire des Parisiens. […] C’était un éléphant de quarante pieds de haut, construit en charpente et en maçonnerie, portant sur son dos sa tour qui ressemblait à une maison jadis peint en vert par un badigeonneur quelconque, maintenant peint noir par le ciel, la pluie et le temps. […] Il était là dans son coin, morne, malade, croulant, entouré d’une palissade pourrie souillée à chaque instant par des cochers ivres ; des crevasses lui lézardaient le ventre, une latte lui sortait de la queue […]. Quoi qu’il en soit, pour revenir à la place de la Bastille, l’architecte de l’éléphant avec du plâtre était parvenu à faire du grand ; […] [Gavroche] entra par une lacune de la palissade dans l’enceinte de l’éléphant et aida les mômes à enjamber la brèche. » Les Misérables, Victor Hugo
L’aéroparis, un projet planant
Et si on pouvait rentrer de vacances en atterrissant.. directement sur la Seine ? C’est ce qu’a imaginé André Lurçat en 1932, en lançant le projet inédit de construire un “Aéroparis” : une piste d’atterrissage en pleine ville, construite sur l’île aux Cygnes, aujourd’hui connue pour son parc et sa Statue de la Liberté miniature. Le tarmac aurait surplombé le viaduc de Passy côté nord, et au niveau de l’actuelle promenade, sous la piste surélevée, auraient été aménagés des hangars et des services pour les passagers. Encore une fois, l’idée était peut-être trop ambitieuse : la taille de la piste n’était pas compatible avec la plupart des avions de l’époque, et les inquiétudes liées à la perte de végétation sur l’île ont fini par enterrer l’idée.
La Pyramide du Père-Lachaise

Une nouvelle fois, les idées extravagantes de Napoléon ont bien faillit métamorphoser Paris ! Après l’éléphant géant prévu place de la Bastille, place à la pyramide au milieu des tombes. En 1803, le préfet de Paris décrète l’affection des 17 hectares du Mont-Louis à la construction du cimetière du Père-Lachaise. L’architecte Alexandre-Théodore Brongniart est chargé de concevoir les plans du cimetière, avec l’ambition d’en faire un lieu propice au recueillement et à la promenade. Il imagine au cœur du site une imposante pyramide de 30 mètres de haut, de couleur orangée, destinée à abriter les cérémonies des différents cultes. Ce projet étonnant témoigne de l’engouement de l’époque pour le style égyptien, né après la campagne d’Égypte de Napoléon entre 1798 et 1801. Finalement, cette pyramide ne verra jamais le jour : à sa place, une chapelle de style néoclassique fut bâtie en 1823 -moins audacieux !
La verrière Horeau

Au milieu du XIXe siècle, il est urgent d’assainir les rues parisiennes, devenues un vrai chaos. L’architecte Hector Horeau s’attelle à cette mission et imagine une immense verrière recouvrant les Grands Boulevards, qui devrait offrir une balade abritée paisible pour les parisiens. De Bastille à Madeleine, montée sur des charpentes métalliques, la verrière se voulait multifonctionnelle : ponctuée de boutiques, théâtres, salles de fête, le tout entièrement démontable et le long d’allées plantées : un projet assez visionnaire !
“Dotées d’allées plantées et de jardinières géantes suspendues à la structure, voici les rues parisiennes transformées en serres végétales, où ornements de fer et luminaires s’offrent aux regards des badauds, de même que les vitrines d’innombrables boutiques. […] offrir une promenade qui manque à Paris, dont on pourrait jouir en toute saison et qui serait un des puissants attraits de la capitale » Hector Horeau en 1868 dans les colonnes de la Gazette des architectes et du bâtiment.
L’aérodrome gratte-ciel de 2 000 mètres

Encore un projet de tour surréaliste ! Il faut dire qu’au XXe siècle, la tour devient le symbole ultime de modernité — c’est la course à la plus haute, la plus spectaculaire, la plus futuriste. En 1934, en plein entre-deux-guerre, Henry Lossier et Louis Faure-Dujarric imaginent un aérodrome gratte-ciel s’élevant à 2 000 mètres de haut. Cette grande perche aurait eu pour fonction de défendre la capitale en cas de nouveau conflit, comprenant trois plateformes destinées au décollage d’avions de chasse, et un souterrain conçu pour évacuer la ville en cas d’attaque. Ce projet vertigineux était totalement irréalisable avec les moyens de l’époque, mais témoigne bien de la crainte constante de la guerre ancrée dans les consciences de l’époque.



/2025/04/07/gettyimages-2208565255-67f3d01a181c3687455897.jpg?#)


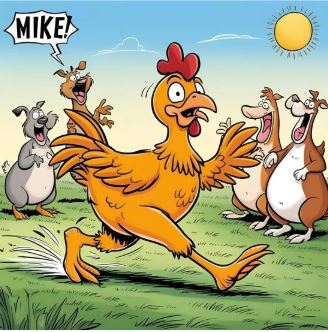



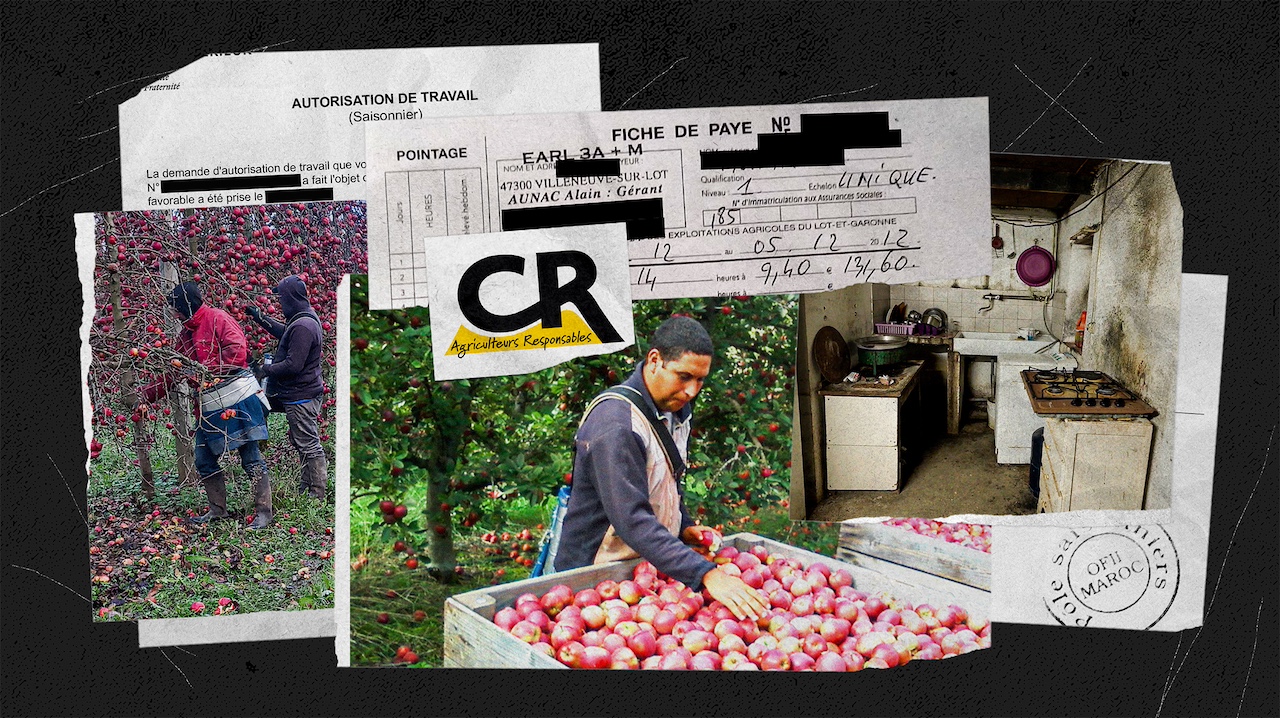


/2025/04/11/vignette-franceinfo-min-67f910e804d84542126873.png?#)
/2025/04/10/oxana-a-67f7be460b899954738258.webp?#)
/2019/10/11/phpWULEWP.jpg?#)