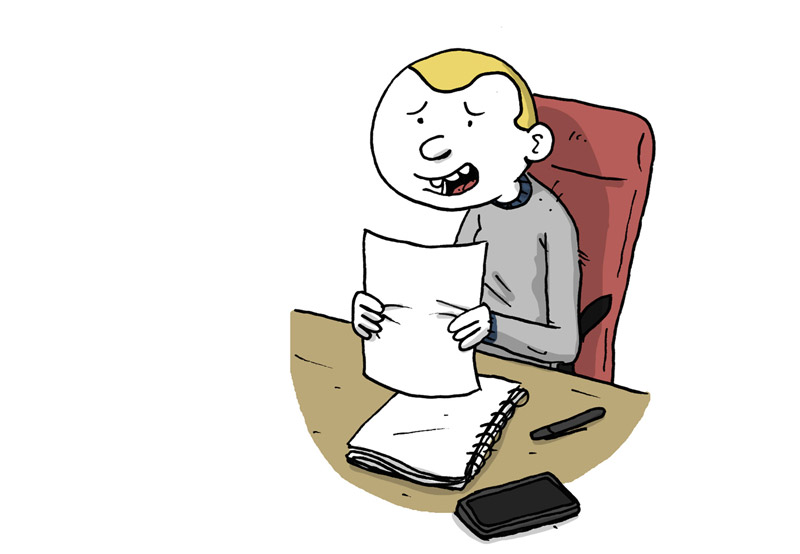Musée d’Orsay : l’affiche, art phénoménal du Paris de la Belle Époque
“L’art est dans la rue” titre le musée d’Orsay pour introduire sa nouvelle exposition dédiée à l’âge d’or de l’affiche. C’est sans rappeler que ces oeuvres de Jules Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec ou Alfons Mucha, avant d’être un “art”, apparaissaient comme le langage d’une ville nouvelle, rythmée par l’industrie et le divertissement. Jusqu’au 6 juillet […]

“L’art est dans la rue” titre le musée d’Orsay pour introduire sa nouvelle exposition dédiée à l’âge d’or de l’affiche. C’est sans rappeler que ces oeuvres de Jules Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec ou Alfons Mucha, avant d’être un “art”, apparaissaient comme le langage d’une ville nouvelle, rythmée par l’industrie et le divertissement. Jusqu’au 6 juillet 2025, l’exposition rassemble 230 affiches pour explorer ce chamboulement social tout en évoquant les dimensions esthétiques et politiques.
L’affiche, un phénomène social
Avant d’être considérée comme un art, l’affiche est appréciée comme une technique nouvelle, celle de la lithographie en couleurs en grand format, permettant une reproduction rapide et efficace d’un message publicitaire qui accroche le regard des chalands. Aussi, les affiches illustrées se multiplient dans les rues parisiennes, faisant la promotion de produits hygiéniques et de vêtements à la mode vendus en abondance dans les grands magasins, ces “cathédrales du commerce moderne” dont parle Zola.

À travers des clichés d’époque appartenant au musée Albert-Kahn, on découvre de quelle manière les murs de la ville sont progressivement envahis d’images en tout genre, donnant naissance aux colleurs d’affiches et aux hommes-sandwichs. Dès lors, l’affiche construit le paysage urbain, comme le souligne Maurice Talmeyr : “La véritable architecture, aujourd’hui, celle qui pousse de la vie ambiante et palpitante, c’est l’affiche, le pullulement de couleurs sous lequel disparaît le monument de pierre”.
Une scénographie réussie à Orsay
Il n’est pas si habituel de relever la créativité scénographique des grandes expositions du musée d’Orsay, qui semblent davantage miser sur la popularité des sujets. Cette fois, on a tout de même envie de s’y arrêter. Certes, les cartels nous laissent parfois sur notre faim : on aurait aimé une lecture historique et sociologique plus détaillée sur cet événement majeur qu’est l’apparition de l’affiche dans les rues. Toutefois, on est ravi de la sélection variée des oeuvres, des différents prismes politiques et esthétiques, et du parti pris de faire dialoguer des affiches iconiques avec leurs esquisses.

Dernier élément à soulever : deux “vestibules” séparent les trois thématiques, pièces sans accrochage, seulement dotées de miroir, qui offrent une respiration et un peu de mystère à cette exposition. Voilà une idée inventive !
L’art pour tous
Au fil du parcours, on découvre la diversité des styles des affichistes – dont on garde en tête, à juste titre, les grands noms de Mucha et Toulouse-Lautrec, tant leur inventivité parvient à marquer durablement l’esprit. On relève toutefois la franchise et l’impertinence d’Henri Gustave Jossot, ou encore le lyrisme de Georges-Antoine Rochegrosse.

Ce qui ressort de cet ensemble d’affiches plus ou moins iconiques, c’est aussi l’esprit contestataire, radical, provocateur, qui peut être une stratégie commerciale, mais sert aussi une revendication politique. Accessible à tous, cet art populaire permet ainsi d’interpeller le passant et d’exprimer librement des idées, ce qui lui confère un caractère bien plus subversif que la peinture, alors jugée trop bourgeoise. Avec des artistes engagés comme Théophile Alexandre Steinlen ou Jules Grandjouan, l’exposition se clôt sur une dimension essentielle de l’affiche : son dynamisme, tant esthétique qu’intellectuel.
Romane Fraysse
L’art est dans la rue
Musée d’Orsay
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing, 75007 Paris
Jusqu’au 6 juillet 2025
À lire également : Exposition : Artemisia Gentileschi, l’intensité en clair-obscur d’une peintre baroque
Image à la une : Louis-Robert Carrier-Belleuse (1848-1913), L’Étameur, 1882 Huile sur toile, 64,8 × 97,8 cm Collection particulière Photo Studio Redivivus
/2025/04/01/zabou-67ebf09bc2a78494026285.jpg?#)
/2025/04/02/val-kilmer-67ece29b0a996061679978.jpg?#)







/2025/04/02/000-38r47cq-67ecbc859d8ad162583159.jpg?#)
/2025/03/24/natatcha-presque-hotesse-de-l-air-a-67e15843df339246116164.jpg?#)














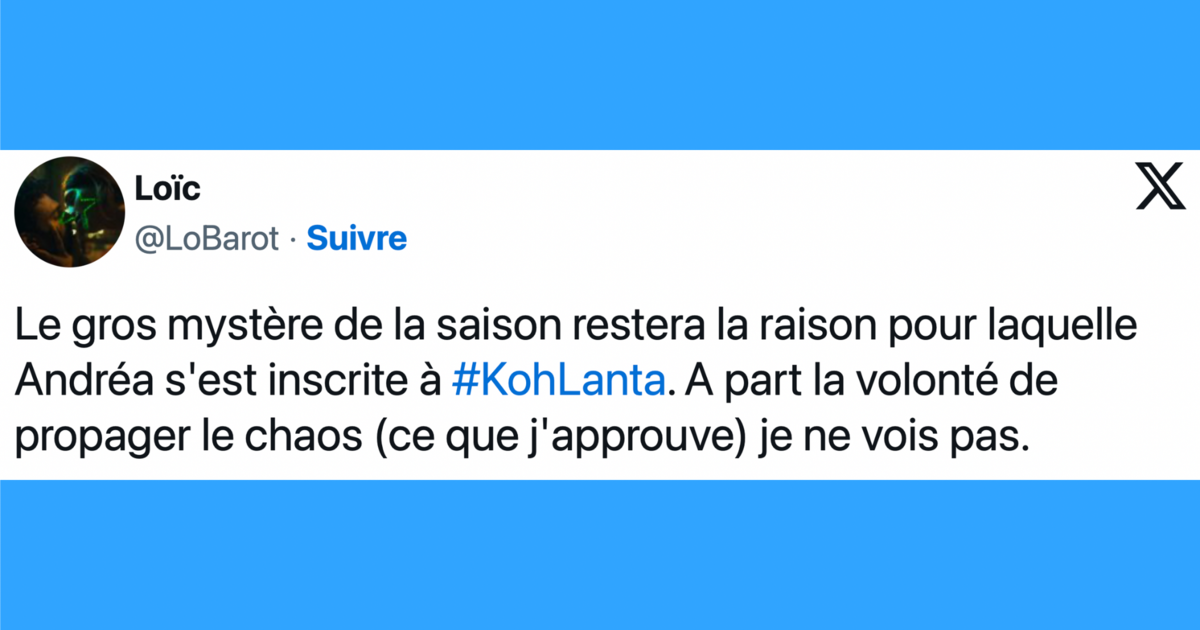








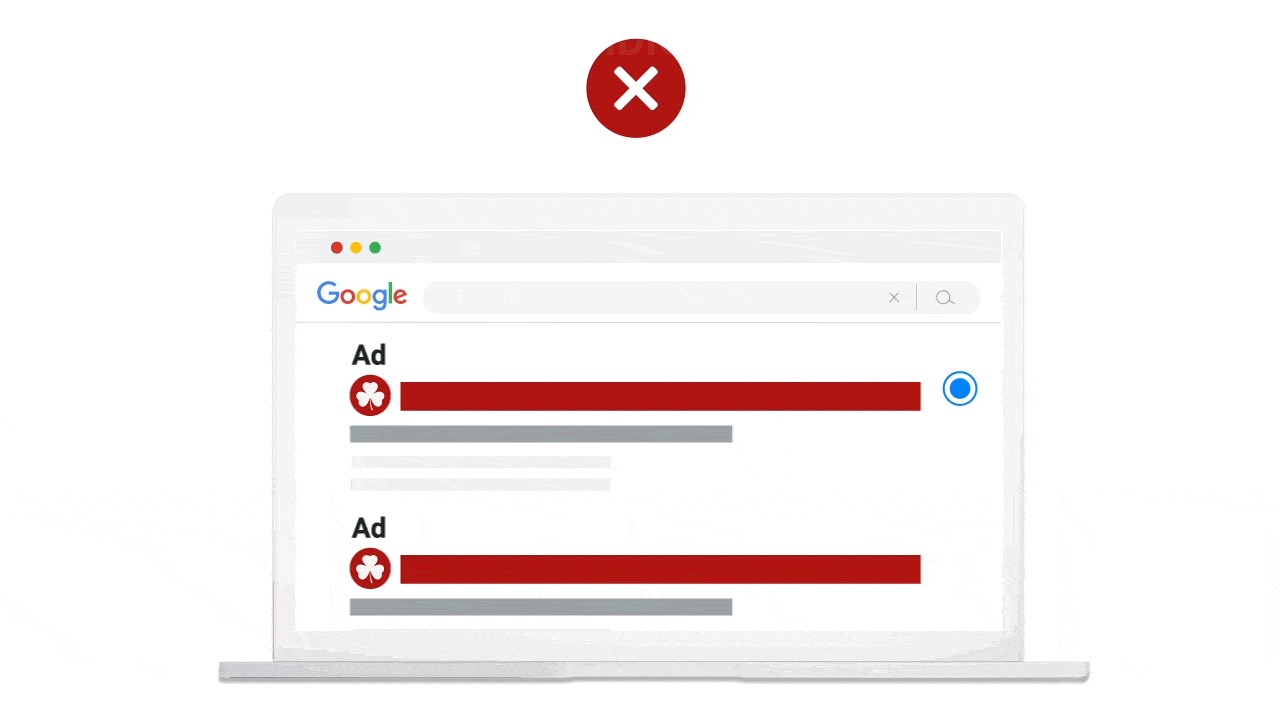























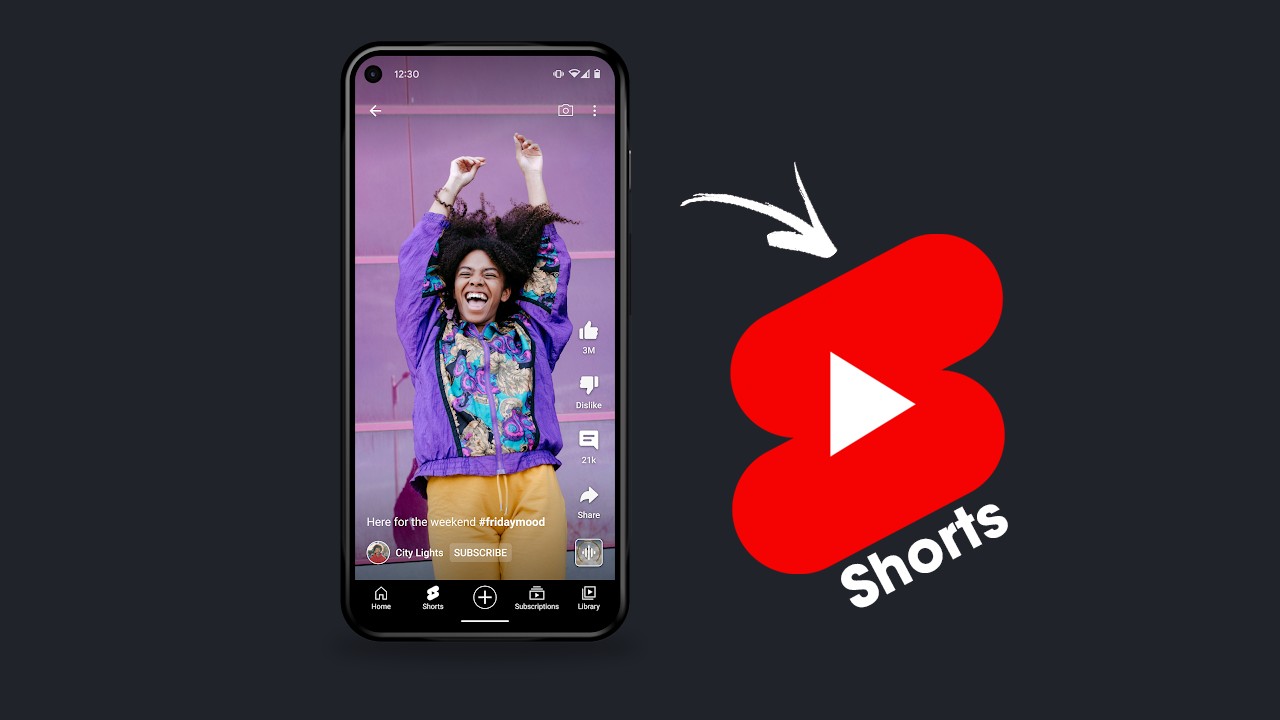


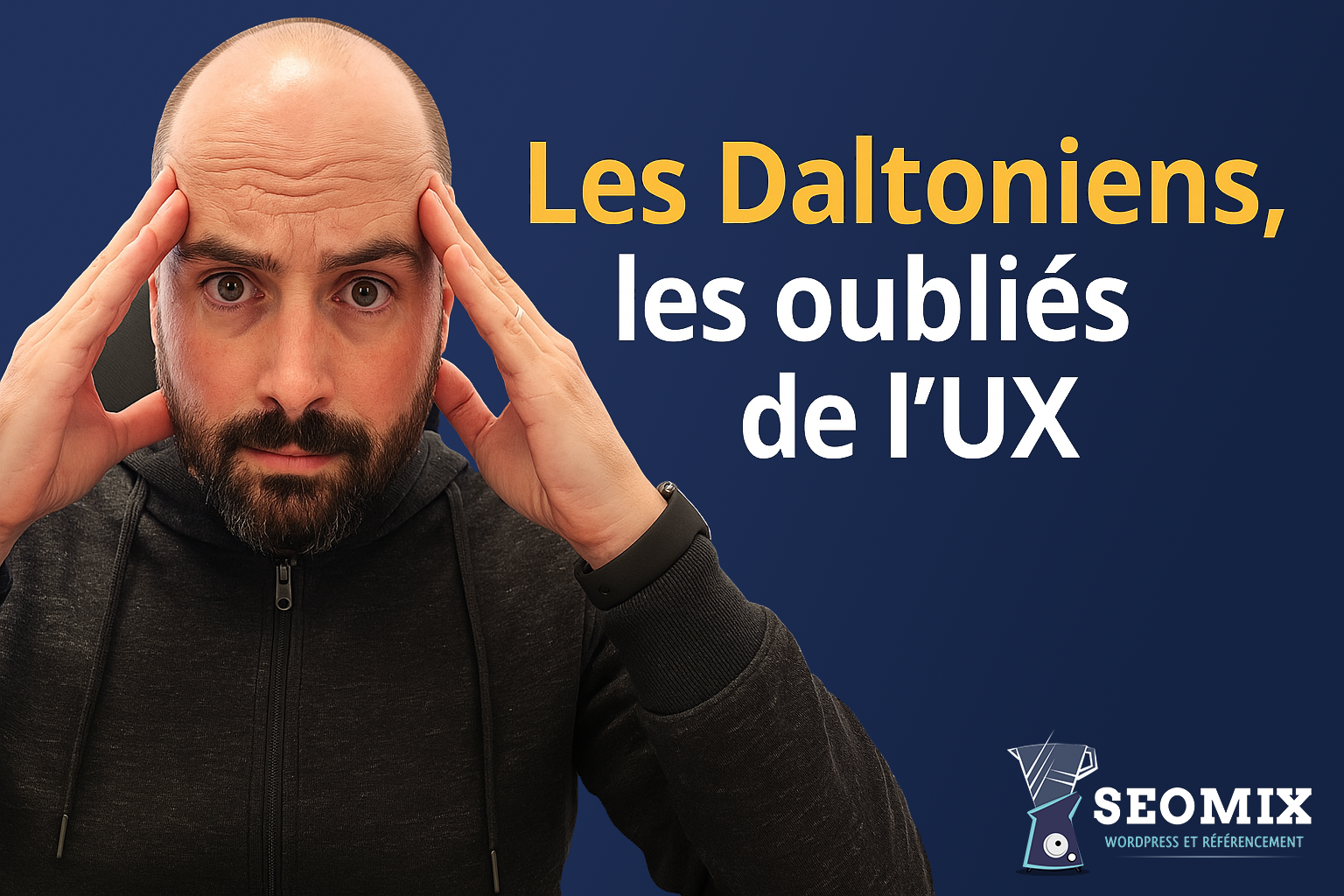


















![Bilan 2024 : Les nouveautés Agorapulse pour booster votre stratégie sociale [Infographie]](https://www.agorapulse.com/fr/blog/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/FR-New-Favorite-Agorapulse-Features-of-2024-Blogpost-Header-scaled.jpg?#)



























![[De]tour : un tour de France en van à la rencontre des artisans du design durable](https://blog-espritdesign.com/wp-content/uploads/2025/03/photo-15-04-2006-03-57-30.jpg)